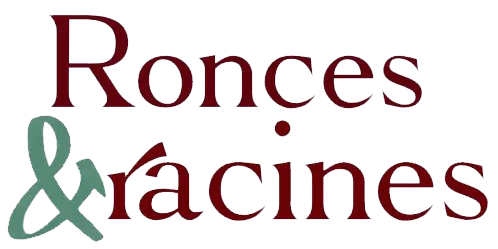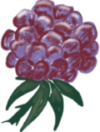Toutes les sociétés humaines, à notre connaissance, font la différence entre les personnes de sexe féminin et celles de sexe masculin. C’est un fait de la nature puisque nous sommes des animaux ayant une reproduction sexuée. Cette différence est constatée, pas imposée socialement. Ce qui, par contre, est imposé par les sociétés patriarcales, c’est une hiérarchie entre mâles (individus de sexe masculin) et femelles (individues de sexe féminin). Le féminisme a pour but de mettre fin à cette hiérarchie en déracinant le patriarcat, ce qui implique de transformer intégralement nos sociétés.
I/Femme ou homme : question de sexe ou d’identité de genre ?
II/Identité de genre, définitions
« Concernant le cerveau, il n’existe probablement rien de tel qu’un cerveau « masculin » et un cerveau « féminin » […]. Une compréhension du cerveau comme fonctionnant et se structurant sur un modèle de mosaïque, incluant des éléments dits « masculins » et « féminins », semble plus proche de la réalité. »
« De la science aux médias en passant par les conversations du quotidien, les débats qui opposent l’inné et l’acquis sont profondément ancrés dans notre culture et partent souvent du principe que l’une ou l’autre option est, dans un sens, plus « acceptable » que l’autre. […] Ces questions s’expliquent par le fait que, dans la culture anglo-américaine actuelle, les gens accordent souvent plus de légitimité aux choses quand elles trouvent leur « origine » dans notre cerveau ou notre ADN. Nous tenons à préciser ici qu’il importe peu que le genre d’une personne s’explique par des raisons biologiques, psychologiques ou sociales – ou une combinaison des trois. »
« Filles et garçons ont-ils le même cerveau ? Oui, ils ont le même cerveau ! Du point de vue de l’anatomie, c’est-à-dire de la forme et de la structure, le cerveau d’un fœtus de fille est identique au cerveau d’un fœtus de garçon ! »
« L’identité de genre se définit généralement comme la façon dont nous nous percevons. »
« Chaque personne a une identité de genre ; elle correspond à ce que profondément, on se ressent être, entre fille/femme, homme/garçon, quelque part « entre les deux » ou au-delà […]. Il s’agit donc d’un ressenti, et aussi d’une image mentale de soi. »
« Identité de genre : Expérience intime et personnelle de son genre profondément vécue par chacun·e, qu’elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance. »
« Identité de genre : Conviction intime d’appartenir à un genre donné : homme, femme, transgenre ou tout autre terme identifiant (genderqueer, non-binaire ou agenre ou agender). Peut correspondre ou non au sexe attribué à la naissance. »
« Identité de genre : Compréhension et expérience intimes que nous avons de notre genre, et la manière dont on le définit. »
III/Stéréotypes sexistes et enfumage intellectuel
Il faudrait donc, selon cette dernière définition, croire sur parole et sans aucune remise en question la déclaration d’identité de genre d’un·e enfant de trois ans, d’une jeune personne souffrant de troubles psychiatriques sévères ou encore d’un pédocriminel condamné et en détention ? Il faudrait donc croire en une identité qui ne se base sur rien de matériel et peut se définir d’autant de façons qu’il y a de personnes revendiquant la même étiquette ?« Comme [Margaret] Mead, [Simone de] Beauvoir et [Judith] Butler nous l’ont expliqué, à la différence du sexe, le genre n’est pas anatomique mais social. Ce sont les membres de la société (vous et nous) qui le construisons et le font évoluer. […] Le genre se négocie aussi au niveau individuel. […] Plus que social, le genre est aussi psychologique. »
« Le genre est une notion complexe, qui comprend plusieurs dimensions, dont l’identité de genre, les rôles et les expressions de genre. Le genre est aussi une construction sociale et englobe les attentes socialement construites qui désignent des rôles, des identités et des comportements particuliers comme étant appropriés soit pour les femmes, soit pour les hommes..»
« Pour résumer, le genre est hétérogène plutôt que binaire – à tous les niveaux : biologique, psychologique et social. […] Nous aimons utiliser le terme « biopsychosocial » pour illustrer le fait que, chez tout individu, l’expérience du genre associe de manière complexe des aspects biologiques, psychologiques et sociaux. »
« Transgenre : personne qui ne se reconnaît pas dans le genre associé à son sexe biologique. On peut avoir un pénis tout en ayant le sentiment profond d’être une femme (femme trans). Ou avoir un vagin et se sentir homme (homme trans). »
« Transgenre ou « trans » : personne dont l’identité de genre – son expérience intime et personnelle du genre – ne coïncide pas avec le sexe biologique qui lui a été assigné à la naissance. »
« Identité de genre : L’identité de genre (on peut aussi juste parler “du genre” d’une personne) est le facteur sociologique d’appartenance à un genre ou plus, qui forme les ensembles humains composant une société. L’identité de genre est majoritairement fondée sur des données biologiques à la naissance, considérées comme inhérentes et objectives. S’ajoutent des facteurs liés à la culture et transmis par l’éducation qui font de ce genre perçu comme biologique une vérité sociale qui conditionne l’intégration d’un individu. »
« En définitive, une personne trans se sent effectivement d’un genre donné, parce qu’elle est dudit genre, et c’est cela qu’il vaut mieux verbaliser : un homme trans est un homme. »
« Petit, j’ai toujours senti que je n’étais pas comme les autres filles de mon âge […]. Je traînais avec des garçons, je jouais au foot avec eux, je portais des joggings, des pulls larges et des baskets. En grandissant, j’ai essayé d’être plus féminin mais vers 15 ans j’ai compris que ce n’était pas possible, alors j’ai recommencé à m’habiller au rayon hommes et je me suis coupé court les cheveux. Un an après, j’ai compris que j’étais un homme transgenre. »
« Sur le plan du genre, je suis une personne non-binaire – ou genderqueer – âgée d’une petite quarantaine d’année. Pour moi, cela signifie que je me situe quelque part au milieu du spectre entre masculin et féminin, et que certains aspects de ma personnalité sont plus « masculins », « féminins » ou « androgynes ». »
« Quand j’étais enfant, je ne me posais pas la question de si je me sentais fille ou garçon. Puis au collège, j’ai eu l’impression que tout à coup, on me considérait complètement autrement18 . J’ai compris quelle place19 j’avais aux yeux des autres, et ça ne m’allait pas. Toujours en 4e, je me suis coupé les cheveux, et dans le métro on m’a dit « monsieur » et « jeune homme ». Et là, je me suis senti mieux, j’ai eu le sentiment d’être bien. »
« Au théâtre, je pouvais échapper à mon sexe – et tout ce qu’il impliquait de bonne conduite hétérosexuelle – pour devenir Van Helsing, Aladdin ou le narrateur non identifié. Sur scène, peu importait si j’échouais à performer la féminité blanche, car ma voix grave, ma présence et mes manières masculines y étaient des atouts. Sur scène, je pouvais tomber amoureux·se de Jasmine et le public m’applaudissait. »