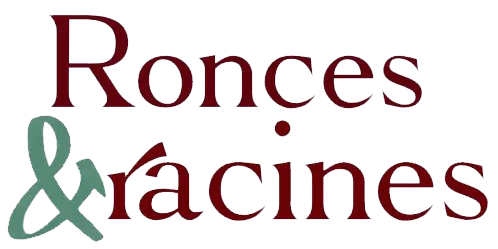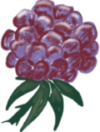349
Position n°1 : ça n’arrive pas
Position n°1 : ça n’arrive pas
Selon l’industrie de la santé mentale, la réponse invariable à ces deux questions est : « mais nan ».
Les acolytes d’Harry Benjamin
Selon Benjamin, homosexuel·les et transsexuel·les sont deux catégories bien distinctes. Endocrinologue de profession, il s’est aussi improvisé expert en psychologie. Ses théories ont influencé la première vague de thérapeutes « spécialistes du genre » états-uniens.
Dans Le Phénomène transsexuel (1966)1, Benjamin explique que le transsexuel mâle n’est pas gay puisque :
« Il n’aime pas [le style de vie gay]. En vérité, il n’aime pas les homosexuels et ressent n’avoir rien en commun avec eux. »
De même pour les lesbiennes :
« Sexuellement, les transsexuelles femelles peuvent être des amantes passionnées, séduisant les femmes ainsi que le feraient des hommes, mais elles ne le font pas comme des lesbiennes, qu’elles détestent souvent profondément. »
Ainsi persuadé que personnes transsexuelles et homosexuelles ne sont pas les mêmes individus puisque appartenant à des catégories bien distinctes, Benjamin affirme :
« L’homosexuel est un homme et ne souhaite pas être autre chose. Il est simplement excité sexuellement par d’autres hommes. Même s’il est du type efféminé, il est toujours en harmonie avec son sexe mâle et son genre masculin. »
(Comme de nombreuses personnes quand elles discutent de l’homosexualité masculine, Benjamin a tendance à être assez phallocentrique.) Benjamin écrit aussi que les travestis (fétichistes) ne souhaitent pas avoir recours à une chirurgie de réassignation sexuelle.
Des docteurs du genre ayant de réelles compétences en psychologie se sont raccrochés au modèle inventé par Benjamin, que j’ai appelé la fausse trichotomie. Jusque dans les années 1980, les médias, et même des juges, ont consciencieusement rabâché cette affirmation que les homosexuels sont bien distincts des transsexuels2.
Une dernière chose concernant les « transsexuel·les classiques » de Benjamin : il dit qu’iels s’identifient avec le sexe opposé dès l’enfance. C’est une expérience courante chez les gays et les lesbiennes.
Ira Pauly
Les docteurs du genre durent éventuellement admettre que des personnes homosexuelles sollicitaient leurs services et que peu parmi elles correspondaient à la description du parfait transsexuel de Benjamin. Cela n’a pas empêché des thérapeutes de premier plan dans ce domaine de nier la réalité pendant encore des années, créant une distinction douteuse entre transsexuel·les « primaires » et « secondaires ». En 1983, le psychiatre Ira Pauly, en collaboration avec d’autres, a présenté un article affirmant ceci :
« [Certains maintiennent] que les patients sollicitant une réassignation sexuelle sont généralement des transsexuels secondaires, c’est-à-dire des travestis et des homosexuels féminins… Nous constatons cependant que la plupart de ces demandes proviennent bel et bien de transsexuels primaires dont l’identification à l’autre genre remonte à l’enfance, et se présentent de façon stable sur une période de plusieurs années. »
À peu près à la même époque, Pauly faisait transitionner une jeune lesbienne de 14 ans.
Les bloqueurs de puberté
Les enfants peuvent être perçu·es comme féminin·es ou masculin·es dès leur plus jeune âge mais leur sexualité ne se développe qu’à la puberté. Cela amène certain·es à s’identifier à des personnes de l’autre sexe avant qu’iels ne puissent découvrir leur orientation sexuelle – cela donne à l’identification trans une longueur d’avance d’une décennie, qui devrait légitimement faire craindre aux professionnel·les de santé un faux diagnostic. Mais bien des chef·fes de file de la profession ont, au contraire, certifié que cela n’est pas possible puisque « l’identité de genre » est réelle et se développe indépendamment de la sexualité.
Des psychologues prétendent, depuis au moins 1972, que l’identité de genre se fixe dès la petite enfance. John Money3, dont le travail soutenant cette thèse a été discrédité au cours des années 1990, fut le premier champion de cette doctrine.
Quand des médecin·nes du genre aux États-Unis ont commencé à utiliser des bloqueurs de puberté sur des enfants de 12 ans dans le cadre d’une transition, au milieu des années 2000, iels répétèrent les hypothèses (jamais prouvées) de Money concernant la formation d’une identité de genre dès l’enfance, sans jamais le citer.
La World Professional Authority for Transgender Health (WPATH)4, dont certains membres sont des professionnel·les de la santé mentale, reconnaît dans son septième « Standard of care5 » publié en 2012 (SOC7) que la plupart des enfants prépubères désistent* et se révèlent homosexuel·les en grandissant. Cependant, l’organisation prétend que le premier jour de puberté est une ligne rouge qui, une fois franchie, change tout :
« À l’inverse, la probabilité que la dysphorie de genre continue jusqu’à l’âge adulte semble être bien plus importante pour les adolescent·es. Aucune étude prospective formelle n’existe à ce jour. Cependant, lors d’une étude portant sur 70 adolescents et adolescentes ayant un diagnostic de dysphorie de genre et auxquel·les ont été données des hormones bloquant la puberté, toutes et tous ont décidé de continuer avec des interventions de réassignation sexuelle. »
D’autres chercheurs et chercheuses ont lu cette étude (provenant du fameux « protocole hollandais ») et ont suggéré que les bloqueurs ont pu perturber le processus naturel se produisant à la puberté et qui permet habituellement à ces jeunes d’accepter leur sexe. Mais la WPATH n’a pas pris cette hypothèse en considération, traitant plutôt cette seule étude comme une preuve irréfutable que des jeunes de 12 ans s’identifiant à l’autre sexe ne désisteront plus, ce que leur suggérait déjà leur immense sagesse ancestrale. Des professionnel·les de santé se sont par la suite appuyé·es sur le SOC7 pour recommander l’usage de bloqueurs de puberté.
Avant même le SOC7, un des principaux doctorants dans le domaine du genre, le psychologue Richard Green, avait fait pression sur les autorités de santé britanniques pour qu’elles recommandent la prescription de ces fameux bloqueurs de puberté. Il connaissait pourtant parfaitement la littérature concernant le désistement des adolescent·es puisqu’il avait écrit en 1987 un livre intitulé The Sissy Boy Syndrome : The Development of Homosexuality6.
La direction de la clinique Tavistock
Fut un temps, la clinique Tavistock, spécialisée en psychiatrie, était réputée dans tout le Royaume-Uni. Son service spécialisé dans le développement de l’identité de genre (GIDS) prenait en charge des mineur·es, jusque récemment. La journaliste Hannah Barnes relate dans son livre sur ce service, Time to Think, que « l’homophobie était un problème, selon la plupart [des personnes interrogées pour cette enquête], et tout particulièrement pour les adolescentes qui se présentaient en grand nombre [au GIDS] ».
Barnes cite les observations de la psychologue Kirstie Entwistle, qui pratiquait au GIDS de Leeds :
« Entwistle a été choquée par l’homophobie généralisée dont elle a été témoin lors de ses consultations. Elle affirme que ce n’était pas un sujet discuté par l’équipe et il n’y avait aucune formation sur comment parler de sexualité avec de jeunes gens. »
Si on en croit le Rapport Cass, les thérapeutes de GIDS n’avaient pas pour habitude d’aborder la question de la sexualité avec leurs patient·es. Ce qui signifie qu’il n’y avait pas de dépistage d’une potentielle homophobie intériorisée chez les patient·es mineur·es et qu’il n’y avait pas de discussion avec ces jeunes de l’impact que pourrait avoir sur leurs futures relations amoureuses et sexuelles des effets secondaires tels que l’atrophie vaginale ou le sous-développement du pénis.
Certain·e praticien·ne savaient que de jeunes gays et lesbiennes étaient transitionné·es en masse (on y reviendra très vite), mais l’institution dans son ensemble était dans le déni.
Des praticiens homosexuel·les ont témoigné avoir rapporté leurs inquiétudes à la directrice, Polly Carmichael, qui a alors sous-entendu qu’iels manquaient d’objectivité contrairement à leurs collègues hétérosexuel·les. Carmichael a nié cette accusation. Cependant, une personne travaillant à la clinique a anonymement affirmé à Hannah Barnes que cette peur d’être en train de perpétrer une thérapie de conversion sous couvert de transition provenait « d’un certain nombre de praticiens gays… qui ne sont donc pas neutre à ce sujet ».
D’après le D. Matt Bristow, lui-même ouvertement gay :
« On a entendu des remarques homophobes tous les jours pendant des années et on devait faire avec. Quand on essayait d’adresser le problème en réunion d’équipe, on était tout simplement ignoré. »
Jack Turban
Le DSM‑5 a changé les critères diagnostics du « trouble de l’identité de genre » (gender identity disorder) et l’a rebaptisé « dysphorie de genre ». Il faut maintenant littéralement prétendre appartenir à l’autre sexe pour obtenir ce diagnostic. Autrement, la dysphorie de genre est globalement la même chose que le trouble de l’identité de genre, qui était déjà de toute façon un diagnostic bidon.
Quoi qu’il en soit, ce changement, rendant nécessaire certains mots magiques (« Je suis un garçon ! »), n’a pas été fait sur la base d’études cliniques démontrant leur vertu prédictive.
Les médecin·nes du genre, tels que le psychiatre Jack Turban, choisissent d’ignorer les études attestant le désistement de la plupart des jeunes, en utilisant l’argument que celles-ci portaient sur des enfants diagnostiqué·es avec un trouble de l’identité de genre et non une dysphorie de genre. C’est leur nouvelle excuse ; iels ne se cachent plus derrière les données douteuses utilisées pour le SOC7.
Jack Turban est gay. Il est donc bien mieux situé que le praticien hétéro de base pour se rendre compte du danger que représente pour les jeunes lesbiennes et gays la médecine du genre. Il est aussi mieux placé que le praticien hétéro de base pour se créer une marque de fabrique en tant que gourou LGBTQ.