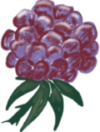Le texte qui va suivre est très personnel, détaillé dans le déroulé des faits, plutôt qu’analytique. Mais en cela même, il dépeint, je crois, une facette significative du phénomène transactiviste, queer et postmoderniste : son mélange d’autoritarisme, de lâcheté, de mauvaiseté, de manque de cohérence. In fine, il révèle la misogynie pernicieuse sur laquelle le mouvement-phénomène repose, ainsi que l’incapacité émotionnelle de la plupart des hommes, qui semblent ne pas percevoir en les femmes des êtres humains qui méritent bienveillance et considération. Les femmes qui consolident elles aussi le patriarcat y seront malheureusement également évoquées.
Il s’agit du récit d’un évènement qui m’a affectée, marquée, tant par sa laideur que par la luminosité qui s’en est suivie. Ce petit ébranlement personnel, comme un tapis poussiéreux qu’on secoue, a fait voleter des questions qu’il me semble valable de se poser. De quel côté se place-t-on : celui de la lâcheté grégaire, de la crainte et du refoulement de notre pensée critique, ou celui des amitiés-camaraderies profondes, solides et fondées sur des valeurs communes ?
J’ai essayé d’être aussi honnête et transparente que possible, sur ce qu’il s’est passé et sur ce que j’ai ressenti. Il m’a fallu un an pour me mettre à rédiger ce texte, je n’avais pas trouvé le courage avant : il est donc possible que des détails m’aient échappé ou se soient confondus les uns dans les autres, mais le cœur des évènements, des causes et des raisons sont bien là, car, il faut le dire, inoubliables, et impardonnables.
Mais j’ai décidé de m’y rendre parce que j’aimais cet ami, ça me faisait plaisir de lui faire plaisir en répondant positivement à son invitation. On avait passé de jolies journées ensemble lorsque je lui avais rendu visite quelques semaines auparavant à l’étranger, et puis il était lui aussi venu chez moi et chez mes parents, et puis simplement j’avais envie de le revoir, bref, je pouvais bien faire cet effort.
En plus, j’allais retrouver quelques autres amis de longue date, avec lesquels j’ai beaucoup partagé, ri, discuté par le passé. Au cours des huit dernières années , on avait voyagé ensemble, été les uns chez les autres, bu d’innombrables bières, dessiné des cadavres exquis, joué pendant des heures, échangé sur nos expériences, nos doutes, nos trajectoires. Jusqu’à ce que leurs réponses à mes messages se fassent plus distantes, laconiques voire ghostantes1 aux entournures. Enfin, chacun sa vie, n’est-ce pas, si j’essaie de toujours me rendre disponible pour celles et ceux qui comptent à mes yeux, je ne m’attends pas toujours à ce que ce soit réciproque car nos quotidiens sont différents (ayant fait en sorte que ma vie soit fluide, non régie principalement par le travail rémunéré, j’accepte souvent de consacrer plus de temps aux autres qu’ils ne m’en dédient eux-mêmes).
Ainsi, je surmontais mon aversion des grands rassemblements d’ingénieur·es et autres cadres diplômé·es, et passais toute la journée entre trains et covoiturages pour me rendre dans les Vosges, où une auberge entière avait été accaparée pour l’occasion. Lorsque j’arrivais, en fin de journée, le soleil était presque assoupi. Une vingtaine de jeunes gens se trouvait déjà sur place, parfois depuis la veille.
Soit, me dis-je, peut-être sont-ils très investis dans leur jeu, après tout je ne m’y connais pas en concentration de billard, nous nous retrouverons plus tard. Je ressens un tout petit serrement au cœur, mais je fais bonne figure et m’en vais rejoindre mes autres amis.
J’arrive sur la vaste terrasse, et voilà deux autres visages familiers, peut-être ? Paul, à l’autre bout de l’immense table – mais son regard est fuyant. Il est loin, me dis-je, nous parlerons après ! Et Martin, dont c’est l’anniversaire, et que j’avais donc vu peu de temps auparavant. Je me raccroche à lui, je suis fatiguée, nous commençons à discuter.
Chose étrange, je sens les coups d’œil des autres autour de la table, que je ne connais pas ou très peu, s’agglutiner sur moi sans jamais soutenir mon regard. Furtifs, d’une curiosité malsaine : il y a quelque chose de très désagréable. Mais peut-être que je me trompe, que j’interprète mal ? Ah, si l’on savait comme les femmes, les féministes, les féministes radicales, se remettent en permanence en question ! Notre refus du gaslighting2 queer contemporain (on refuse de dire qu’un homme est une femme) ne vient certes pas de nulle part. On a tant douté de nos convictions, toujours remises en cause, avant d’oser les exprimer. Avant d’oser affirmer qu’elles sont bien de gauche, et radicalement, et même plus que de gauche, anarchistes !, qu’elles sont nourries par notre désir de justice et non par une quelconque haine, par un besoin de critique rigoureuse, de réflexion honnête plutôt que de suivisme irréfléchi.
Je pars me chercher une bière. Une femme bavarde dans la cuisine, pourrait-elle m’indiquer où sont les verres ? Elle me répond sèchement, de façon aussi vilaine que malpolie.
Je m’extirpe alors peu à peu de mon déni initial : oui, quelque chose cloche dans cette atmosphère nauséabonde.
Ainsi quelque chose de ma parole (égrenée ici et là en ligne, à l’époque encore pas très virulente) a dû déplaire à cette non-binaire, qui en a sûrement aussitôt averti le groupe. La prise de distance de mes « amis » s’est opérée à partir du moment où j’ai osé parler des femmes afghanes opprimées en raison de leur sexe (rendez-vous compte !) sur Instagram, puis s’est probablement amplifiée lorsque j’ai dénoncé la violence transactiviste que je me suis prise quelques semaines auparavant, lorsque l’un d’entre eux a cru bon de me menacer de mort en ciblant précisément mon lieu de travail.
« Sale pute transphobe », « Je vais te planter au couteau sale truie de terroriste », « Pute de transphobe », « On va te brûler à vif », etc. Ces messages, je les ai affichés sur les réseaux numériques, parce que j’ai refusé de me laisser faire – et ce qu’en concluent mes « amis », qui ne m’ont pas envoyé un seul mot de soutien, c’est que c’est moi qui suis « problématique » (le mot de la décennie, qui ne veut rien dire mais permet d’évincer sans plus de justification quiconque nous déplaît).
Depuis, ils ne m’avaient jamais rien écrit, rien rétorqué, n’avaient jamais confronté mes idées, mais continuaient d’épier mes paroles sur les réseaux dits sociaux, de m’y « suivre » et de prendre des captures d’écran de mes prises de position « pas OK ».
Ici peut-être est-il bon de préciser que, moi-même, je trouve les joutes politico-personnelles par écrans interposés misérables et plus que ridicules. Elles incarnent à merveille une époque où la réflexion sérieuse et le courage politique sont relégués en arrière-plan : ce qui compte, ce sont les petits narcissismes brossés dans le sens du poil (teint en bleu). Ce qui compte, c’est de montrer patte blanche à l’idéologie dominante à gauche (le transqueerisme), même lorsqu’on n’est pas en adéquation avec celle-ci, parce qu’on craint trop de perdre son statut social, son job, ses ami·es. Et, vu la violence du phénomène, probablement à raison, mais ça ne légitime pas la lâcheté pour autant, surtout lorsqu’elle implique de dénigrer, mépriser ou volontairement ignorer l’engagement d’autrui. Par les temps qui courent, dans un contexte de montée générale d’idéologies fascisantes, il me semble plus important que jamais, au contraire, d’affirmer avec courage ses positions de gauche, féministes, antiracistes, antihomophobie. Le fait est que le néo-culte de l’idéologie de l’ « identité de genre » passe principalement par les réseaux numériques, qui ont eux-mêmes activement participé à le promouvoir depuis une bonne dizaine d’années. En tant qu’anarchistes et gens de gauches, n’oublions pas que le transqueerisme repose sur le capitalisme extractiviste, la technologisation numérique du monde, l’industrie pharmaceutique et médicale.
Violence ? Oui, me dit-il, mes récentes « prises de position publiques » féministes. C’est-à-dire, je l’ai évoqué plus haut mais détaillons, quand j’ai rappelé la cause de l’oppression des femmes afghanes par les Talibans, à savoir leur sexe. Quand j’en ai conclu qu’il était indécent que des mâles se réapproprient nos réalités corporelles, car si nous ne pouvons pas nommer la raison (l’infériorisation artificielle de notre sexe) et les perpétrateurs (les hommes) de notre oppression, comment serions-nous censées la combattre ? Ces faux amis qui n’ont jamais prononcé un mot authentique de soutien féministe, ils sont devenus les juges suprêmes en ce qui concerne le peuple-auto-déclaré-le-plus-opprimé-du-monde (je parle ici des trans, pas des sionistes, c’est vrai que ça peut porter à confusion, tant règnent le mensonge et la victimisation outrancière dans ces deux groupes).
Ils ont donc conspiré contre moi avant ma venue, et Martin n’a pas jugé bon de me prévenir, de me suggérer de ne pas venir. Martin, comprenez, c’est pas sa faute : lui il s’y connaît pas sur le sujet, il a jamais rien lu mais du coup il juge pas, lui, il est neutre et gentil, et veut juste que sa fête d’anniv se passe bien. Il s’en fout, en fait, de mon avis renseigné sur la question, à vrai dire il s’en fout de la question trans et du féminisme. Que des mecs esquintent les droits et la dignité des femmes, en quoi ça le concernerait ?
Donc lui, le pauvre, il pensait pas que la situation « serait à ce point », avec un tel silence et au mépris de notre amitié à tous. Je suis sidérée. Je ne lui en veux pas encore (« le pauvre » ! j’ai même de l’empathie pour cette situation inconfortable dans laquelle il est, écartelé entre ses ami·es, c’est dire à quel point l’on est socialisée, en tant que femme, à prioriser les autres), mais je suis traversée de vagues de chaleur, en apprenant cette désertion silencieuse de mes « amis » et cette sorte d’humiliation publique de m’avoir fait venir, sans rien me dire, au milieu de ces gens hostiles. C’est drôle comme cette soirée s’est traduite par des phénomènes physiologiques forts, comme nos sentiments et pensées sont liés à nos sensations et nos corps. Ce n’est pas pour rien que les féministes insistent : nous sommes nos corps.
Je décide alors de quitter le dîner pour me réfugier un temps dans la chambre – un dortoir partagé, pas d’intimité pour réfléchir et se retrouver, mais pour l’instant tout le monde est en bas. Je ne sais que faire, que penser, que ressentir. Je ne peux même pas partir, l’endroit est vraiment paumé, il n’y a pas de transport, il fait nuit, je suis coincée ici avec ces gens qui me font sentir qu’ils souhaitent mon absence. J’ouvre mon téléphone pour me changer les idées, et par un heureux hasard, je discute ce soir-là avec une autre féministe qui a récemment subi l’ire de l’incroyable et bienveillante communauté queer. Ça me met du baume au cœur de pouvoir échanger avec elle, qui ne se laisse pas faire, qui est courageuse.
Martin se pointe dans la chambre – mal à l’aise le gars, c’est vrai que l’ambiance n’est pas géniale, forcément. Il s’excuse pleutrement et compatit vaguement, par ses « désolé je ne pensais pas que ce serait à ce point ». Ah bon ! Mes amis médisent de moi sans me permettre le moindre droit de réponse, attendent que je passe sept heures de route à me réjouir de les retrouver pour mieux m’ignorer de vive voix, mais il s’est pas dit que ça poserait problème !
Et là il m’apprend ce qu’il n’a pas eu le courage de me dire plus tôt, à savoir l’ampleur du délire : ce ne sont pas uniquement mes « amis » qui me cancellent3 (ce texte, je m’en excuse, est truffé de vocable laid et ridicule, mais que voulez-vous, le transqueerisme est un phénomène politique global, un cas de contagion sociale tout droit venu des USA, il propage et impose sur son passage sa panoplie d’outils langagiers dont on ne peut presque plus s’extraire). En effet, la vingtaine d’ingés en présence s’est forgé la veille, dans mon dos et dans un acte de splendide bravoure, une opinion sur moi – ne m’ayant pour la plupart pourtant jamais rencontrée. Je serais transphobe, problématique (que ces anathèmes sont vides de substance) voire d’extrême-droite (soyons fous·x·y·z). Ah, et violente surtout : une femme qui exprime un avis critique, et sans prendre de pincettes en plus, c’est probablement ce qui se fait de plus violent, de nos jours.
Comprenant que je suis venue me foutre dans ce bourbier de vingt cadres dynamiques hostiles, qui semblent tous et toutes me vouer un certain degré d’aversion du fait de mes considérations féministes, je me mets à pleurer (je suis très sensible, mais en plus je suis en SPM, un joli combo lié, ironie du destin, à mon corps de femme). Je suis envahie par deux sentiments : celui d’une injustice crasse, et celui d’un mépris immense envers « ces gens-là ».
Parmi eux, ceux qui me connaissent savent que je m’engage à différents sujets, que je refuse l’indifférence, que je consacre temps, énergie, ressources, efforts à quelque chose que j’estime plus important que ma petite personne, à des causes qui sont pour moi justes et importantes, et auxquelles il me paraîtrait impossible, non éthique, de ne pas me dévouer ne serait-ce qu’à ma petite échelle. Ils savent, en outre, que j’ai été récemment harcelée et insultée par un transactiviste violent. Ils savent tout ça – et c’est moi qu’ils décident d’isoler, d’ostraciser de cette manière odieuse, de ghoster dans la vraie vie. De ne même pas me saluer ouvertement au nom de l’amitié qui a été.
Puis, en appréhendant cet état de fait l’espace de quelques secondes, je suis envahie d’un sentiment de mépris considérable. Ces piètres individus n’ont pas été foutus de venir me parler de ce qui leur a si fortement déplu dans mes écrits, de me confronter sur le terrain des idées et des arguments, de s’exprimer franchement lorsque je venais encore prendre de leurs nouvelles ou leur payer leur fanzine de luxe pour les soutenir.
N’ont pas eu le cran d’arrêter honnêtement de me parler ou de me « suivre », continuant d’espionner mes positions pourtant si « contraires à leurs valeurs ». Et au-delà de tout ça, n’ont pas eu l’humanité de me considérer comme une personne, qui mérite respect et considération quelles que soient ses opinions politiques. À vrai dire, je suis sûre qu’ils ne se seraient jamais comportés de la sorte envers un mec de droite, même d’extrême-droite, c’est pourquoi, selon moi, la misogynie et le mépris enraciné des femmes expliquent le surgissement de telles attitudes collectives.
Sur ces entrefaites, la deuxième organisatrice de la soirée, qui fêtait conjointement ses trente ans et qui a quand même dû se sentir un peu coupable de la manière dont la soirée se déroulait, entre dans la chambre. Dans un élan progressiste, elle m’assomme de platitudes : « tu sais, c’est OKayent de pleurer » (je sais pas ce que les pro-queers ont avec cette expression, « c’est OK », à croire qu’ils ne peuvent articuler leur pensée plus loin que sur un mode binaire, c’est OK/c’est pas OK, bien/pas bien, problématique/pas de problème…). « Peut-être que ça ferait du bien de crever l’abcès », ajoute-t-elle… On croit rêver. Quel abcès, celui que mes potos ont laissé grandir des mois durant et qu’ils ne sont toujours pas foutus d’aborder ce soir encore ? « Peut-être que tu peux quand même profiter du week-end de ton côté ? » Comme si j’allais rester un instant de trop dans cet endroit de malheur ! Certes, j’ai pas d’autre choix que d’y passer la nuit, mais dès l’aube je m’extrairai de la situation et du lieu et ne les reverrai jamais.
Je décide de redescendre, prendre l’air, la néo-trentenaire pro-alliée-queer m’accompagne, elle fournit plus de soutien émotionnel à mon encontre que mon propre « ami » Martin. D’ailleurs, c’est elle qui gère toute l’organisation de la soirée, alors que c’est leur anniversaire à tous les deux, étonnant hein. Même dans cette situation je ne peux m’empêcher de noter la différence de socialisation féminine et masculine. Puis elle me laisse, j’ai envie d’être seule et de réfléchir à tout ça.
Sur la pente d’une colline, il y a un cimetière rempli de tombes en vrac et de silence. J’y entre et m’assoit sur l’une d’entre elles, de là je peux contempler l’auberge avec ses petites lampes à l’intérieur et sa musique un peu nulle. Je suis trop loin pour entendre les conversations basiques des trentenaires occidentaux qui s’y trouvent ; je m’imagine, sans faire preuve d’aucun effort de créativité, des « on a pu acheter grand oui, on avait un apport pas négligeable tu sais les beaux-parents ont aidé », « ouais on part à Malte pour un gros week-end le mois prochain », « wow ta veste Patagonia est stylée je vais me trouver la même », etc.
Je me perçois assise là, seule dans le cimetière, mon eyeliner dérivé par les larmes et les chauves-souris au-dessus – très emo, très dark, ça me fait rire, le ridicule de la situation. Finalement, les effets de groupe que je détestais tant au collège et au lycée n’ont en rien évolué, la plupart des individus sont toujours aussi consternants, ils ont érigé en devise le fait de ne « pas faire de vagues ». Cela dit, je ne me sens pas honteuse du tout, j’ai appris à être à l’aise avec la confrontation ou la mise à l’écart par les autres : la seule chose qui me ferait honte, ce serait de renoncer à la morale et à l’intégrité qui étayent ma conduite de petit être vivant.
Rassérénée par cette prise de recul inopinée et somme toute drôle, je retourne vers la grande bâtisse à colombages. Et je décide que, tant qu’à être là, je vais quand même profiter de la soirée, et si ça les dérange, qu’ils parlent. Je reviens dans la salle commune au moment où les concerné·es par le poids de la trentaine soufflent leurs bougies.
Je discute un peu avec les deux seuls mecs qui n’étaient pas au courant de ma non-fréquentabilité (car ne faisant pas partie des alumnis ingés). Ils me demandent si je passe une bonne soirée, me voyant seule sur un canapé à simplement observer les scènes sociales devant moi. Très honnêtement, je leur réponds, « oui super, mes amis ne m’adressent pas la parole et tout le monde me prend pour une facho du fait de mes opinions féministes, fondées en outre sur le souci réel du bien d’autrui. » Ils sont choqués, et on discute un moment.
Il se fait vaguement tard (à l’échelle de ma fatigue physique et émotionnelle du moins), je me sens complètement vide, alors je décide de prendre congé de cette soirée formidable. Je m’insère dans un lit, avec la musique débile d’en bas, et en sachant que d’autres viendront partager ma chambre plus tard. Je voudrais m’assoupir, mais c’est peine perdue, comment ne pas être tourmentée par ce genre de chamboulement émotionnel qui s’apparente bien à une trahison ? J’en suis tellement bouleversée que je passe une bonne partie de la nuit à vomir et à pleurer. Sympa, n’est-ce pas, mais c’est la réalité des conséquences de l’effet grégaire des meutes stupides sur leur cible. Je ne vais pas le cacher. La maltraitance psychologique a toujours des effets physiologiques puissants.
Je passe une nuit blanche, comme au bon vieux temps de mes études d’architecture dans cette satanée école d’ingénieurs. Au petit matin, quand il fait jour, je peux enfin partir. J’espère ne croiser absolument personne. Le temps est solaire, splendide, la nature autour de la maison est luxuriante. Que ces lâches se confisent dans leurs effluves d’alcool, je me sens soulagée de n’avoir plus jamais avoir affaire à eux.
Par un drôle de hasard temporel, c’est ce même matin que j’ai rencontré, par l’intermédiaire d’une connaissance qui m’a appelée pile à ce moment-là, un nouveau cercle d’ami·es, tellement plus intègres, engagé·es et brillant·es que ceux qui venaient de m’abandonner. Des personnes non seulement honnêtes et courageuses, mais drôles, sérieuses, géniales dans tout ce qu’elles savent faire – qui, plutôt que de se morfondre dans la médiocrité (érigée en identité par les gus qui m’ont cancel ce week-end-là), s’activent à vivre une vie digne et à rendre le monde un peu plus vivable. Des personnes que j’aime aujourd’hui profondément, qui continuent de m’inspirer, de la même manière que ces femmes incroyables que j’ai eu la chance de rencontrer autour du combat pour la Palestine et de la lutte féministe – elles aussi radicales, lumineuses et remarquables d’intelligence et de bonté.
Aujourd’hui, peut-être, la situation prend une teinte plus prometteuse, puisqu’au Royaume-Uni, la Cour Suprême a reconnu l’année dernière que « femme » désigne bien un sexe, et non un ressenti sexiste (on en est là, en termes de victoire : quelle régression, ces dernières décennies, pour le féminisme !). Puisque de nombreux scandales quant à la médication et à la mutilation de mineur·es qui se disent trans ont éclaté. Puisque la communauté transqueer ne cache plus la violence de ses militant·e·x·y·z, qui appellent littéralement au meurtre et au viol de femmes qui sont en désaccord avec leur idéologie.
Toujours est-il qu’il me semble important de dire ce qui a été, et ce qui risque d’être encore ; de ne pas oublier, de ne pas croire les alliés des queers quand ils retourneront leur veste pour déclarer qu’en réalité, ils auront toujours été du bon côté de l’histoire, n’est-ce pas, ils n’auront jamais fait partie de la meute avide de violence stupide et misogyne, eux… Et, de manière plus générale, il est nécessaire de dénoncer l’ampleur de tout phénomène sectaire qui, au nom de la doctrine, en vient à ostraciser socialement des personnes désignées comme ennemies, bien souvent des femmes.
J’aimerais que le partage de mon témoignage, qui peut paraître insignifiant pris individuellement, encourage d’autres femmes à s’exprimer sur la façon dont les (pro)transqueer les ont traitées, rabaissées, évincées de sphères où elles avaient toute légitimité d’exister, de prendre une place et de s’exprimer. Puissions-nous ainsi dégonfler le ridicule ballon de baudruche de l’idéologie trans !
Anir